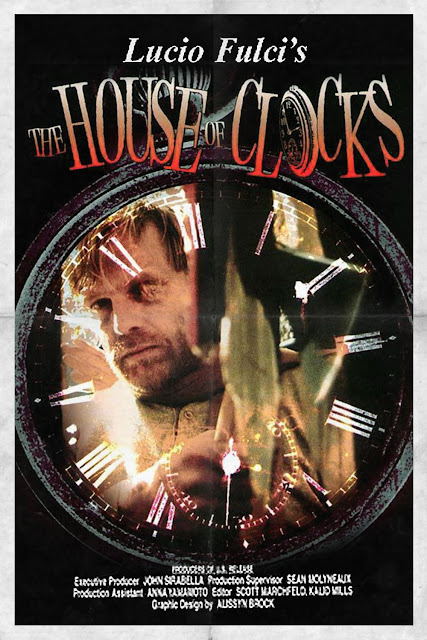Sorti en 1980, Blood
Beach
est le troisième long-métrage du réalisateur américain Jeffrey
Bloom qui avant cela avait tourné les deux comédies
Dogpound Shuffle en 1975 et The Stick Up deux
ans plus tard. Avec son troisième long-métrage, il se décide
finalement à changer de registre et signe une petite série B
horrifique qui malheureusement ne fait pas de vagues. Un comble pour
un film se déroulant principalement sur une plage sous le sable de
laquelle une créature s'en prend aux touristes. Aspirés sous le
sable, ils disparaissent les uns après les autres sans que les
autorités ne soient en mesure de l'attraper. On ne peut pas dire que
le Sergent Royko se sente véritablement investi d'une mission de la
plus haute importante. Quant au Lieutenant Piantadosi, il a beau se
montrer inquiet de la tournure que prennent les événements, on ne
le verra jamais vraiment s'affoler. S'il ne fallait qu'une preuve du
peu d'implication des deux flics dans cette affaire, il suffit
d'assister à l'hallucinante scène durant laquelle un certain Alan
Hench, porté disparu, remonte des égouts dans un état déplorable.
Alertés par les hurlements stridents d'une femme, Royko et
Piantadosi s'en approchent... tranquillement... sans avoir vraiment
conscience de la situation. Et dire qu'ils sont chargés de protéger
leurs concitoyens... on se demande dans quelles proportions ces deux
là ont été projetés par hasard dans les services de police...
Vu dans sa version
''Uncut'', je pensais que
cela voulait signifier que Blood Beach (traduit
chez nous sous le titre La Plage Sanglante)
était plus sanglant. En fait, dans le cas présent, cela veut
surtout évoquer le fait que l'on s'y emmerde davantage que dans la
version charcutée. Des séquences coupées à l'époque pour que le
film puisse sortir en salle accompagné du symbole de classification
''Rated R''
signifiant qu'une personne âgée de dix-sept ans ou moins était
autorisée à aller voir le film accompagnée d'un adulte. Entre les
deux versions, une poignée de secondes de différence seulement dont
la plus notable demeure sans doute la présence d'une main griffue
s'en prenant à la jambe de l'une des victimes de la créature. Le
reste n'a aucune sorte d'intérêt, les ajouts ne constituant qu'un
total d'un peu plus de trois secondes. La chose ne serait pas tant à
déplorer si Blood Beach n'était
pas si navrant. Est-ce parce que le titre à lui seul est générateur
de fantasmes chez l'amateur d'horreur, mais de sang, le spectateur
avide d'hémoglobine va devoir faire sans et ranger pour un temps son
enthousiasme. À part quelques furtives effusions de sang, le film de
Jeffrey Bloom ne tient pas du tout ses promesses. Du moins le titre
qui sans doute dans l'esprit des spectateurs promettait une
succession de scènes gore mais qui au final offre le minimum
syndical...
C'est
donc tout naturellement vers le récit et les interprètes que le
spectateur sera contraint de se retourner à défaut de jouir de
scènes d'horreur dignes de ce nom. Mais là encore, c'est le vide
sidéral. L'histoire, d'abord intrigante, s'avère au final
terriblement plate. Le scénario est d'un vide abyssal et
l'interprétation à égal intérêt. Connaissant certains des
interprètes, leur piètre jeu ne peut être mis qu'au crédit d'un
réalisateur aux abonnés absents. Car comment reconnaître sinon que
Burt Young (nominé pour son rôle dans Rocky
de John G. Avildsen en 1976 et interprète chez Roman Polanski, Sam
Peckinpah, Damiano Damiani ou Stuart Rosenberg) ou John Saxon (La
Fille qui en Savait Trop
de Mario Bava en 1963, Black Christmas
de Bob Clark en 1974, Ténèbres
de Dario Argento en 1982, Les griffes de la Nuit
de Wes Craven en 1984) soient si peu convaincants à l'écran ?
Otis Young (Les Bannis,
Columbo : Jeu d'identité),
Marianna Hill ( El Condor de
John Guillermin en 1970, Le Parrain 2 de
Francis Ford Coppola en 1974) et David Huffman (Firefox,
l'Arme Absolue en
1982) font le taf mais c'est peut-être finalement l'actrice Eleanor
Zee dont la carrière est essentiellement télévisuelle qui demeure
la plus convaincante dans le rôle de la clocharde muette Mrs.
Selden. Là encore, un comble ! Blood Beach
ne tient absolument pas ses promesses en matière d'horreur. Si le
titre est trompeur, la réalisation est relativement médiocre et
déteint sur l'interprétation d'un casting pourtant intéressant. Si
passer une heure et vingt-cinq minutes devant un film où il ne se
passe pas grand-chose ne vous dérange pas, alors Blood
Beach est
fait pour vous. Pour les autres, veuillez passer votre chemin...