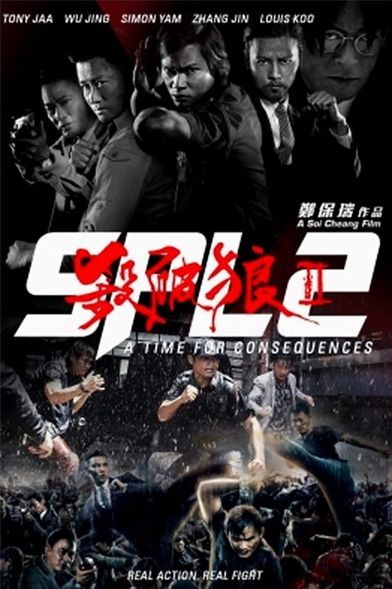Lorsque l'acteur
américain Richard Harrison accepte de tourner dans le nouveau
long-métrage du réalisateur, scénariste, acteur, romancier et...
libraire (Mdr) français Norbert Georges Vincent Moutier, sans doute
est-il loin d'imaginer que sa promesse allait le contraindre de
participer à l'un des plus gros film Z de l'histoire du cinéma !
Une œuvre fauchée comme un champ de blé en jachère, qui voit le
jour au tout début des années quatre-vingt dix tout en ayant l'air
d'avoir été tourné vingt ans plus tôt. Un film d'espionnage,
d'arts-martiaux où sont au menu trahison, séduction, attaque au
sabre et aux armes à feu par des ninjas et des militaires... Tout ça
pour une mallette contenant apparemment les plans d'un réacteur
nucléaire. Surtout
''connu'' pour avoir mis en scène l'ultra Z Mad
Mutilator,
Norbert Moutier a également marqué les esprits des amateurs de
lectures sanguinolentes en écrivant les sympathiques Neige
d'enfer
et L'équarrisseur
de Soho
pour la collection Gore
des éditions Fleuve
Noir
en 1988 et 1990. En huit long-métrages réalisés en quinze ans et
sous divers pseudonymes, l'ancien rédacteur du fanzine Fantastyka
n'hésite pas à mouiller la chemise en signant avec Opération
Las Vegas
l'un de ces objets filmiques les plus invraisemblables qui soient.
Démontrant ainsi la remarquable absence de talent d'un auteur malgré
tout très optimiste quant au résultat obtenu une fois déclenché
le clap de fin ! Prompt à faire habituellement chier les
réalisateurs bis italiens, sachons balayer devant notre porte en
évoquant cette fois-ci l'un des plus remarquables pourvoyeurs de
nanars hexagonaux. Le fond de l'œuvre signée de Norbert Moutier
lui-même ayant moins d'importance que la forme, c'est sur cette
dernière que reposera tout l'intérêt d'une telle projection. Ceux
qui survécurent à l'expérience Mad Mutilator
savent déjà à quoi s'attendre. On peut d'ors et déjà leur
assurer que l'expérience sera bien moins pénible. Et ce, malgré un
montage et un mélange bordélique des genres qui n'aident absolument
pas au confort du spectacle étalé devant nos yeux. Si le
réalisateur et scénariste semble prendre les choses très au
sérieux, le spectateur, lui, risque de pouffer de rire assez
régulièrement. Vêtu d'un costard trois pièces, dans le rôle de
Jefferson, Richard Harrison est quand même le seul type au monde à
draguer les filles à bord d'une voiture familiale ! Et
pourtant, cela semble fonctionner.
La
preuve étant qu'il attire dans ses filets une certaine Britta
(interprétée par l'actrice française Brigitte Borghese). Blonde et
bien tanquée, avec ce petit air de P#%@
qui lui sied à ravir... Comment ça une Pute ?
Ça n'est absolument pas ce que j'avais en tête. Pas du tout. Je
pensais plutôt à une Poupée,certes
gonflable, mais certainement pas une Pute !!!
Trêve de plaisanterie. Comme si les nombreuses fusillades filmées
avec l'engouement d'un neurasthénique ne suffisaient pas, on a droit
à une bande-musicale absolument indigeste signée par Garabello
(un rapport avec Jean-Louis Garabello ?). Lorsque l'on parle de
soupe, ici, on évoque évidemment davantage des pommes de terre à
l'eau qu'un délicieux velouté à base de crème fraîche. Côté
doublage, c'est le pompon. En dehors de la blonde Brigitte Borghese
l'on a l'impression que la totalité des interprètes masculins l'on
été par le même doubleur. Expressions et timbre de voix sont
tellement caricaturaux qu'on a souvent l'impression que tous les
personnages furent doublés par Mozinor !
Bon, après, on reconnaîtra Opération Las Vegas
comme
ayant pu être éventuellement une authentique source d'inspiration
pour les frères Coen. N'y at-il pas en effet chez les américains de
The Big Lebowski
une petite touche de cette pépite qu'est la série Z signée Norbert
Moutier sous le pseudonyme de N. G. Moutier ? La seule
''preuve'' étant de mettre côte à côte l'acteur hollandais John
Van Dreelen et l'américain John Goodman. Même tendance (ou presque)
à prendre de la bedaine mais surtout, même tenue vestimentaire.
Pour être tout à fait franc, le film est quand même assez chiant à
suivre malgré sa courte durée qui n'excède que de quelques
secondes les soixante-sept minutes. Heureusement, le spectateur
trouve régulièrement l'occasion de rire. Comme lors de cette
séquence à l'improbable montage durant laquelle un type se rend
compte qu'on lui a remis une mallette piégée. La jetant loin de
lui, celle-ci explose. Lors du plan suivant, le gars s'abrite
derrière sa voiture..... Après l'explosion !!! Pas avant, non,
APRES !!! Bref, le film de Norbert Moutier est un authentique
cas d'école qui ferait bondir n'importe quel prof spécialité dans
le cinéma. Mais alors, parfois, quelle tranche de rigolade...