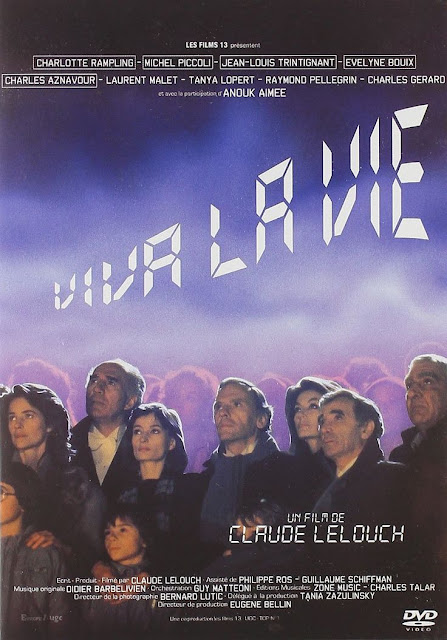Alors que deux
propositions de loi sur la fin de vie et sur les soins palliatifs ont
été examinées par l'Assemblée nationale en séance publique du 12
au 27 mai, le 12 février dernier est sorti en salle le long-métrage
de Costa-Gavras, Le dernier souffle.
Un cinéaste engagé qui à l'âge de quatre-vingt douze ans trouve
encore la force d'aborder un sujet délicat, dans un contexte
mortifère mais aussi et surtout humaniste. Ne nous trompons pas. La
présence à l'image de l'acteur et humoriste Kad Merad ne doit pas
nous faire oublier que le film s'éloigne drastiquement du caractère
habituel des œuvres que l'ancien complice d'Olivier Baroux incarne.
Ici, l'occasion de rire et de sourire se fait rare bien qu'un certain
sens de l'humour permette parfois de désamorcer le climat de
fatalisme qui touche à peu près tous ceux que les spectateurs
auront l'occasion de croiser à l'écran. Kad Merad incarne le rôle
du chef d'un service de soins palliatifs. Très proche de ses
patients, le docteur Augustin Masset fait la connaissance de
l'écrivain et philosophe Fabrice Toussaint qui après avoir subit
une IRM croise la route de cet homme qui voue son existence à
accompagner des patients en fin de vie. Le
dernier souffle
tourne donc principalement autour de ces deux personnages. Œuvre
dans laquelle le sort des patients entre en résonance avec les
inquiétudes de l'écrivain qui lui-même porte en lui les ''germe
endormis'' d'une maladie qui pourrait hypothétiquement se
''réveiller'' et, dans le pire, le voir finir ses jours lui-même
dans un service de soins palliatifs. Très loin encore de ce supposé
postulat, le film est surtout construit autour de différents
témoignages de patients livrés à travers la parole du spécialiste.
Costa-Gavras prend le périlleux pari d'offrir à Kad Merad la
difficile mission d'incarner un personnage formidablement proche de
ses patients. Acteur généralement peu en accord avec ce que l'on
peut attendre de lui lorsqu'il s'agit de transmettre de l'émotion à
l'écran, il trouve cependant ici l'un de ses meilleurs rôles. Posé,
sobre et impliqué, Kad Merad a surtout face à lui un Denis
Podalydès toujours aussi exemplaire.
Le
duo fonctionne à merveille et égaye d'une certaine façon un sujet
qui a priori ne prête absolument pas à sourire. Adapté par le
réalisateur lui-même, le script repose à l'origine sur l'ouvrage
éponyme qu'ont écrit en commun l'écrivain, philosophe et haut
fonctionnaire Régis Debray et le docteur Claude Grange, praticien
hospitalier spécialisé en douleurs chroniques et soins palliatifs.
Plutôt que de suivre en temps réel le quotidien du service du
Docteur Augustin Masset, Costa-Gavras les met en scène lui et
Fabrice Toussaint dans une succession ''d'anecdotes'', de témoignages
relatant certains des cas les plus difficiles et touchants qu'ait eu
à traiter le spécialiste. L'occasion de suivre comme si nous y
étions, le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui vouent leur
existence à celles et ceux qui bientôt vont partir. Constitué de
séquences qui peuvent être envisagées sous la forme d'histoires
indépendantes les unes des autres tout en étant proches par la
thématique qui les lie, Le dernier souffle
s'avère parfois très pesant en ce sens où la Mort rôde
véritablement autour de certains plans. Difficile en effet d'oublier
la séquence entre Augustin Masset et Sidonie qu'incarne la
formidable Charlotte Rampling. Cette manière subtile qu'a le
cinéaste de la faire disparaître de l'image. Ou plus tard, ce point
d'orgue lors duquel Costa-Gavras filme en plongée l'un de ses
patients quelques heures avant sa mort, entouré des siens, modifiant
sensiblement l'intensité lumineuse et rendant ainsi la séquence on
ne peut plus bouleversante... Bref, l'on n'indiquera sans doute pas
Le dernier souffle
aux personnes en période de ''sinistrose'' au vu de son sujet et
pourtant, le film vaut bien quelques sacrifices. Comme celui de
mettre de côté sa peur de la mort ou de partir dans l'indignité
physique ou morale... Notons la présence à l'écran de l'actrice
Marilyne Canto qui incarne Florence, l'épouse de l'écrivain et
philosophe. Si elle débuta sa carrière au cinéma en 1978 avec
L'hôtel de la plage
de Michel Lang, les plus anciens téléphages se souviennent sans
doute d'elle pour sa présence dans la série Joëlle
Mazart
(la suite de Pause-café),
série où l'héroïne était incarnée par Véronique Jannot et dans
laquelle Marilyne Canto incarnait le rôle d'une véritable peste
prénommée Béatrice...

.png)
.png)
.png)