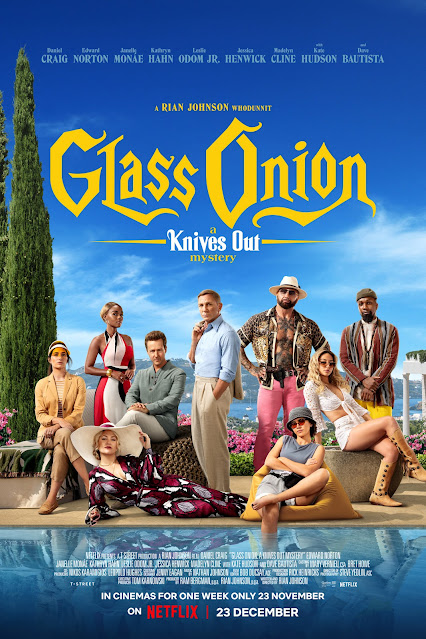Un vieil homme
excentrique invite les cinq plus grands détectives du monde à un
dîner un peu particulier. En effet, Lionel Twain convie Dick et
Doras Charleston ainsi que leur terrier. L'inspecteur Sidney Wang et
son fils adoptif Willie. Milo Perrier et son assistant Marcel
Cassette. Sam Diamond et sa secrétaire Tess Skeffington. Ainsi que
Jessica Marbles et sa fidèle infirmière, Mlle Withers. Toutes et
tous sont conviés dans une lugubre demeure. Mais très vite les
choses se compliquent. Un pont branlant qui menace de s'effondrer au
passage des invités et des statues qui tombent sur la tête des
invités sous le porche de la porte d'entrée. Un sonnette qui
« hurle », un majordome aveugle et une cuisinière sourde
et muette. De dizaines de tableaux et de trophées accrochés aux
murs. Des yeux vides qui permettent à l'hôte de ces lieux d'épier
ses invités.
Lionel Twain a une très
étrange proposition à faire à ses invités. Il les invité en
effet à participer à un dîner durant lequel un crime sera commis
au vu et au su de tous. Celui qui résoudra ce meurtre se verra
empocher la somme d'un million de dollars. Les invités n'ont de
toute façon pas le choix puisque fenêtres et portes sont fermées
et protégées par de solides grilles métalliques...
Réalisé par Robert
Moore en 1976, Un Cadavre au Dessert est une comédie
policière jubilatoire. Un suspens en forme d'hommage à Agatha
Christie qui ne ménage pas les spectateurs en terme de gags puisque
les répliques ne cessent de fuser pour notre plus grand bonheur.
Truman Capote, Alec Guinness, James Coco, Peter Falk, Eileen Brennan,
Elsa Lanchester, David Niven, Maggie Smith et Peter Sellers pour ne
citer qu'eux. Un casting flamboyant pour une intrigue passionnante
située dans un manoir inquiétant. Des effets réussis (pluie,
brouillard), des décors gothiques du plus bel effet et des dialogues
extraordinairement bien écrits. Un Cadavre au Dessert se
doit d'être vu en version originale évidemment. Mais que les
réfractaires ne se fassent pas de soucis. La traduction est parfaite
et la finesse de certains jeux de mots est conservée. Macabre et
drôle, le film n'est pas avare en répliques cinglantes. Les
actrices et acteurs sont tous géniaux. On prend plaisir à les
retrouver, et notamment Peter Falk qui interprète cette fois-ci un
inspecteur beaucoup plus vindicatif dans ses propos que dans
l'excellente série qui l'a rendu célèbre.
On
reconnaît à peine Peter Sellers, ici grimé en japonais qui omet
les pronoms. Le film comprend des scènes d'anthologie comme celle
qui nous convie à assister à un « dialogue » entre le
majordome aveugle et la cuisinière sourde et muette. La fin du film
se termine par une succession de six « twists » finaux
qui succède à une série d'aveux de la part des convives, rappelant
ainsi la plupart des œuvres cinématographiques inspirées par
l’œuvre d'Agatha Christie. Un Cadavre au
Dessert est
donc une magistrale comédie macabre qu'il faut avoir vu au moins une
fois dans sa vie...








.png)
.png)