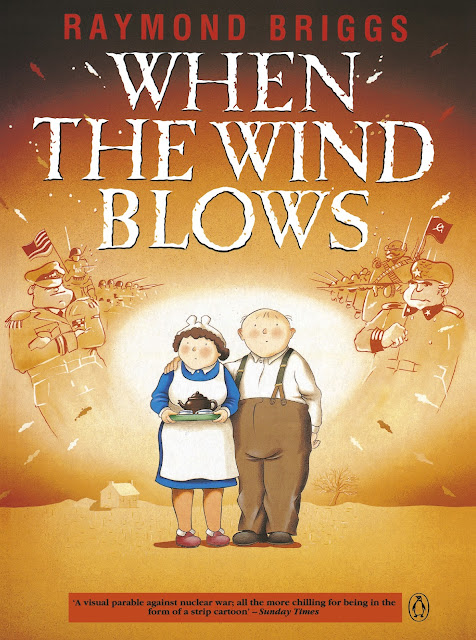Sur les conseils de
Carter69, j'ai ajouté pour
terminer ce cycle consacré à La Peur du Nucléaire,
le film d'animation britannique Quand souffle le vent
(When the Wind Blows)
de Jimmy T. Murakami. À l'image des œuvres précédentes et
notamment de The War Game que
Peter Watkins réalisa en 1965, ce dessin animé qui mêle diverses
techniques dans l'art de l'animation possède une grande valeur
pédagogique. L'on y apprend notamment les préparatifs permettant de
survivre une fois que l'attaque a eu lieu. Dans cet édifiant
long-métrage d'animation, le réalisateur britannico-japonais Jimmy
T. Murakami nous présente pour commencer un couple de personnes
âgées à l'aube de la catastrophe. Elle, vit dans l’insouciance
quand lui, se prépare déjà à exploiter les ressources de leur
maison de campagne isolée. Jim Bloggs (John Mills) démonte
plusieurs portes afin de construire un abri de fortune contre le mur
de leur salon. L'homme bénéficie d'un précieux fascicule distribué
par le gouvernement britannique à ses habitants relatant toutes les
phases leur permettant de se protéger des éventuelles retombées
radioactives. Quand souffle le vent démarre
tout d'abord de manière nonchalante. Le réalisateur bâtit pour ses
personnages, une relation solide qui perdure depuis la seconde guerre
mondiale et même, bien avant. Jim et son épouse Hilda (Peggy
Ashcroft) entretiennent d'ailleurs une étrange relation avec cette
période trouble de l'histoire de l'humanité. Comme un sentiment de
nostalgie. Une authentique et belle histoire d'amour qui survivra
d'ailleurs au drame à venir. Bien évidemment, l'on retrouve le
thème du conflit qui oppose l'Union Soviétique à l'Occident. Comme
un cauchemar qui se répète inlassablement chaque fois qu'un
réalisateur évoque le sujet de la guerre nucléaire. Le récit
repose sur une série de duels qui opposent l'homme et son épouse.
Duels, oui. Mais point de rivalité. Elle conservera presque jusqu'au
bout, du moins jusqu'à ce que le cataclysme promis par les
informations radiophoniques ne se déclenche, l'attitude de la femme
d'intérieur, soucieuse du maintien de son domicile comme de son
mari. Lui, représente la sécurité. Tandis qu'elle vaque à ses
occupations ménagères, lui intègre scrupuleusement les conseils
édictés par le fascicule.
Une œuvre tragique et belle notamment sublimée par les compositions de David Bowie ou de Roger Waters...
D'ailleurs,
sans jamais se poser la moindre question quant à la réelle valeur
de ceux-ci. Dessins enfantins, imagerie fantasmagorique, plans en
trois dimensions, incrustation de stock-shots. Jimmy T. Murakami
passe à la moulinette l'art du dessin, de manière souvent naïve,
certainement pour mieux happer le spectateur au moment où la
catastrophe a lieu. Plus qu'une œuvre catastrophiste, le dessin
animé est un hymne à l'amour, éternel, plus fort que tout, que la
guerre (dont ils gardent un souvenir ému) ou que la mort. Ce qui
émeut dans Quand souffle le vent,
c'est moins le drame qui va frapper ce couple isolé du reste du
monde et qui croira jusqu'au bout pouvoir survivre aux retombées
radioactives que cette force qui unit Hilda et Jim. Le long-métrage
témoigne avant tout d'une vie passée, d'un bonheur au delà de tout
et d'une confiance inaltérable l'un pour l'autre. Avec ses petits
travers qui font partie de la vie et qui nous touchent peut-être
davantage à travers le choix de ces personnages qui d'apparence
semblent plus fragiles que n'importe quels autres. C'est donc moins
pour ses qualités visuelles que pour son message que Quand
souffle le vent persiste
dans nos mémoires longtemps après sa projection. Le réalisateur
vise juste, et ce, sans faire preuve d'atermoiements car bien sûr,
ce beau film est aussi un témoignage terrifiant qui n'épargnera
personne. Ni ses héros, ni les spectateurs. L'horreur de la guerre
dans toute sa monstruosité. Et ne croyez pas que parce qu'il ne
s'agit que d'un dessin animé, Quand souffle le
vent
ne peut avoir la force d'une œuvre tournée dans de véritables
décors avec d'authentiques interprètes. Bien au contraire. D'un
point de vue technique, l'aspect vieillot de l’œuvre est
rapidement contrebalancé par l'alliance entre dessins bruts et
décors reconstitués en trois dimensions, faisant ainsi de la
demeure des Bloggs, un personnage à part entière. Bref, tout comme
The War Game
ou Threads
de Mick Jackson, Quand souffle le vent est
un indispensable. Merci à Carter69
pour cette très belle découverte...