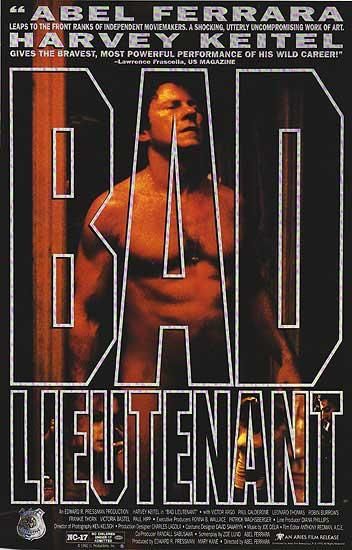Habitué des films
cultes, auteur de El Mariachi,
de ses suites Desperado et
Once Upon a Time in Mexico,
de la tétralogie Spy Kids,
de Sin City,
du diptyque Machete
(que l'on désespère toujours de voir devenir une trilogie) ou de
Planet Terror
et de The Faculty,
le réalisateur, scénariste, producteur et musicien
mexicano-américain Robert Rodriguez signe en 1995 From
Dusk till Dawn
connu chez nous sous le titre Une nuit en enfer.
Un long-métrage constitué de deux parties parfaitement distinctes.
Dans la première, qui s'inscrit dans les genres thriller et action,
nous faisons la connaissance de Seth Gecko et de son psychopathe de
frère Richie. Deux truands qui ont les flics de tout le pays aux
trousses. Leur objectif est de se rendre jusqu'au Titty
Twister,
un bar situé au Mexique et exclusivement réservé aux routiers afin
de prendre contact avec un certain Carlos (l'acteur Cheech Marin
connu pour le duo de comiques Cheech
& Chong qu'il
forma aux côtés de Tommy Chong dès 1971). Pour cela, ils doivent
passer la frontière des États-Unis. C'est en prenant en otage
l'ancien pasteur Jacob Fuller et ses deux enfants à bord de leur
camping-car que les deux hommes y parviendront. À leur arrivée au
Ttty Twister,
le ton change radicalement puisque Une nuit en
enfer
se mue en film fantastique et d'horreur gore. En effet, coincés dans
le bar, les cinq protagonistes vont devoir combattre une armée de
vampires assoiffés de sang ! Heureusement pour eux, ils ne
seront pas seuls. Ils pourront notamment compter sur Sex Machine, un
biker doté d'un flingue en lieu et place de ses attributs sexuels
ainsi qu'un certain Frost. Le long-métrage de Robert Rodriguez est
un pur régal non seulement pour les amateurs de cinéma d'horreur et
d'action mais aussi et surtout pour les amoureux de cinéma bis qui y
dénicheront toute une série d'hommages au septième art le plus
populaire qui soit. À commencer par la présence à l'image de Fred
Williamson, l'un des artistes majeurs de la Blaxploitation
dans le courant des années soixante-dix qui se tourna ensuite vers
le cinéma européen et enchaîna quelques films devenus cultes
auprès d'une certaine catégorie de spectateurs tels que
Les guerrier du
Bronx de
l'italien Enzo G. Castellari ou Vigilante
de William Lustig qui ne fut autre que le réalisateur du cultissime
et très glauque Maniac.
Sex Machine est quant à lui interprété par le maquilleur Tom
Savini, grand spécialiste des effets-spéciaux gore qui travailla
notamment sur Maniac,
justement, ainsi que sur Zombie,
Creepshow
et Le jour des morts-vivants
tout trois signés de George Romero ou encore sur les slashers The
Prowler
et Vendredi 13 : Chapitre final signés
en 1981 et 1984 par Joseph Zito. L'on retrouve également au
générique, Harvey Keitel dans le rôle de Jacob Fuller quatre ans
après sa phénoménale performance dans le traumatisant Bad
Lieutenant
d'Abel Ferrara, l'adorable Juliette Lewis qui à l'époque enchaîne
les succès (Kalifornia
de Dominic Sena, Tueurs nés
d'Oliver Stone ou Strange Days
de Kathryn Bigelow). La vedette de Une nuit en
enfer,
si tant est que l'acteur se détache réellement de ses partenaires,
demeure George Clooney qui depuis la série Urgences
a prouvé qu'il était capable de tout jouer (on l'a notamment
découvert à plusieurs reprises chez les frères Joel et Ethan
Coen). Écrit par le réalisateur Quentin Tarantino qui adapte ici
une histoire de Robert Kurtzman, Robert Rodriguez lui offre le rôle
de Richie Gecko, véritable allumé qui tire souvent sans raisons
sur tout ce qui bouge. Le réalisateur attache une grande importance
à la bande-son et c'est la raison pour laquelle le film est en
permanence noyé de saturations électriques propres au rock. L'on
trouve parmi les interprètes, le célèbre groupe ZZ
Top
ainsi que Stevie Ray Vaughan, Tito and Tarantula (groupe qui apparaît
à l'image sur la scène musicale du bar) ou encore The Mavericks. Au
départ, Quentin Tarantino devait réaliser lui-même Une
nuit en enfer.
Mais préférant se concentrer sur son rôle, la mise en scène
échoue entre les mains de son ami Robert Rodriguez après que
d'autres noms de réalisateurs aient été envisagés. Ce dernier
réalise un hybride parfaitement assumé, survolté, bruitiste et
parfois très gore dont le défaut majeur reste cependant la
conception des effets-spéciaux numériques qui sonnent véritablement
faux. Contrairement aux maquillages qui eux sont plutôt
convaincants ! Robert Rodriguez signe avec Une
nuit en enfer
un authentique classique du cinéma fantastique et horrifique, porté
par des interprètes qui n'ont pas peur de se salir les mains et
accessoirement leur réputation. Un bon gros délire inusable, à
voir et à revoir à de multiples reprises...