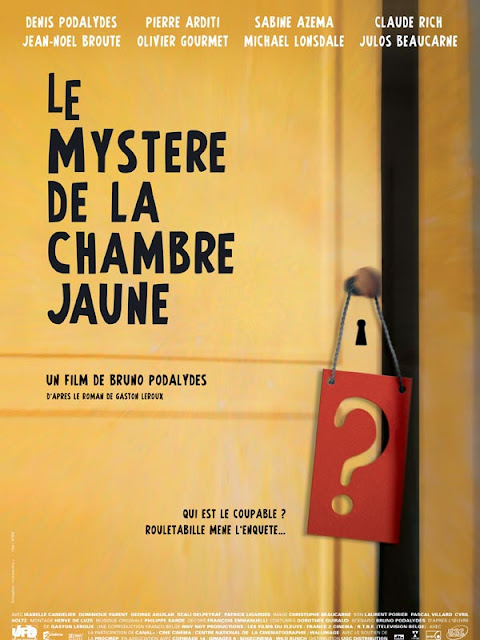Affublée non pas d'un
cheveu mais d'une véritable perruque sur la langue due à une
dyslalie, l'actrice, scénariste et romancière Isabelle Mergault est
connue pour avoir tout d'abord interprété des seconds rôles dans
un certains nombres de films (son personnage de Caroline Derieux
tombait notamment amoureuse du très indiscipliné professeur de
littérature Frédéric Game qu'incarna Patrick Bruel en 1985 dans la
comédie culte de Patrick Schulmann, P.R.O.F.S).
On la vit également participer à plusieurs de ses propres pièces
de théâtre qu'elle interpréta elle-même auprès d'autres
comédiens. Mais avant cela, elle s'était essayée à la réalisation
de longs-métrages cinématographiques dès 2005 avec Je
vous trouve très beau,
suivi en 2008 d'Enfin veuve
et en 2010 avec Donnant Donnant.
Il y a deux ans, elle est réapparue dans le costume de réalisatrice
et de scénariste avec son dernier film, Des
mains en or.
Tout comme pour ce dernier, Isabelle Mergault a signé le script de
Donnant Donnant
aux côtés du scénariste Jean-Pierre Hasson. Le duo nous conte les
déboires de Constant (Daniel Auteuil), condamné à de la prison
ferme pour avoir été reconnu coupable d'assassinat. Pourtant, il le
clame haut et fort : il s'agissait d'un accident. Lors de son
dernier parloir avec son épouse, celle-ci lui annonce vouloir
divorcer. Victime d'un accident vasculaire cérébral, il est emmené
d'urgence à l’hôpital d'où il s'évade pour se réfugier à bord
d'une péniche stationnée sur une rivière. Appartenant à une
vieille femme aigrie prénommée Jeanne (Sabine Azéma), la fille de
celle-ci tombe nez à nez avec Constant et reconnaît l'homme dont
tous les médias parlent actuellement. Silvia (Medeea Marinescu)
propose un marché au fugitif. S'il accepte de tuer sa mère, elle ne
préviendra pas la police et le laissera partir une fois le méfait
accompli. Pris à la gorge, Constant accepte. Mais rien ne va se
dérouler comme prévu. En effet, alors que Jeanne a prévu de se
suicider en se jetant d'un pont situé au dessus de la rivière,
Constant la sauve. En outre, la vieille dame trouve une certaine
ressemblance entre son sauveur et son époux décédé et tombe ainsi
amoureuse de l'homme le plus recherché de France... Il me semble
qu'à l'époque de sa sortie, Je vous trouve très
beau
avait pu jouir d'une petite réputation auprès de certains
journalistes particulièrement indulgents envers Isabelle Mergault et
ses interprètes d'alors. Sans doute cela était-il dû à la
présence au générique de l'acteur Michel Blanc ? Tout aussi
attachant qu'il eut toujours été, l'ancien membre de la troupe du
Splendid ne parvint semble-t-il pourtant à convaincre qu'une toute
petite partie des spectateurs.
Le
film était en outre interprété par l'actrice roumaine Medeea
Marinescu que l'on retrouve donc ici dans le rôle de la charmante
Silvia. Coincée dans une vie non rêvée alors qu'elle ambitionnait
de faire une carrière de pianiste, celle-ci trouve l'occasion
d'hériter de sa mère adoptive en poussant un fugitif au meurtre.
Donnant Donnant
est un ''drôle'' de film. Dont la durée semble vertigineuse au
regard de son contenu. La réalisatrice/scénariste semble vouloir à
nouveau donner sa définition d'une rencontre amoureuse mais le fait
d'une façon si désaccordée avec le cinéma d'aujourd'hui que la
tentative est souvent vouée à l'échec. À commencer par ces
personnages secondaires, ce trio de voisins incarnés par Jean-Louis
Barcelona, Christian Sinniger et Julien Cafaro. D'un ringardisme
absolu, on a l'impression qu'Isabelle Mergault est allée pécher
dans le vivier des acteurs de seconde zone, oubliés du cinéma, et
qu'elle met en scène sans jamais tenter de donner du corps à leur
personnage respectif. Lourds, pas drôles et dont la fonction est ici
parfaitement inutile. Seule Sabine Azéma semble s'amuser dans le
rôle de Jeanne. Volontairement enlaidie lors de la première partie,
elle illumine son personnage lorsque celui-ci fait la connaissance de
celui qu'elle compare à son défunt mari. L'actrice passant de la
vieille dame acariâtre à la MILF
habillée de façon sexy. Quand à l'idylle entre Constant et Silvia,
on a beaucoup de mal à y croire tant Isabelle Mergault semble s'être
confondue en sous-intrigues inintéressantes pour mieux noyer le
poisson et révéler sur le tard les véritables sentiments de la
jeune femme pour le fugitif. Doter Daniel Auteuil de difficultés
pour s'exprimer aurait pu être une grande idée mais le concept
tombe finalement à plat. Là encore, l'on éprouve de grandes
difficultés à rire devant des situations éculées. L'on
regretterait presque que la toute dernière partie, qui demeure la
plus intéressante, n'ait pas été privilégiée par rapport à
cette facette de l'histoire qui se voulait sans doute proche de
l'humour noir s'agissant de l'assassinat programmé de Jeanne. Bref,
Donnant Donnant
confirme qu'Isabelle Mergault n'est pas du tout à l'aise avec son
sujet. Pas aussi médiocre que Michèle Laroque lorsque cette
dernière s'essaie à la mise en scène (les deux femmes se
rencontrèrent d'ailleurs sur le tournage d'Enfin
veuve),
il va décidément falloir qu'elle se reconvertisse rapidement dans
un autre domaine...

.png)
.png)
.png)