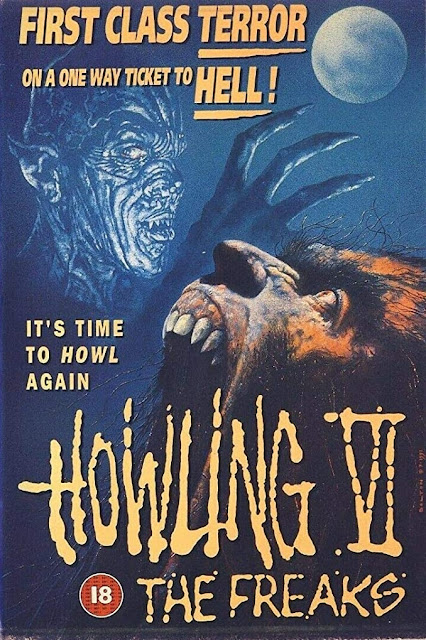En 1982, le réalisateur
allemand Werner Herzog signait l'une de ces expéditions
cinématographiques dont lui seul a le secret. Après avoir notamment
tourné Herz aus Glas dans
le canton des grisons en Suisse et en Bavière en 1976, il retourne
dix ans après son chef-d’œuvre Aguirre, der
Zorn Gottes
filmer au Pérou l'un de ses plus prestigieux longs-métrages.
Fitzcarraldo
met en scène Brian Sweeney Fitzgerald qui arrivé à Manaus après
avoir effectué un long voyage sur les rivières amazoniennes assiste
à un opéra dont la vedette n'est autre que son idole Enrico Caruso.
Dès lors, Fitzcarraldo va entreprendre un rêve fou : celui de
bâtir un opéra en pleine forêt amazonienne. Aidé par des
centaines d'indigènes et accompagné par une toute petite poignée
d'hommes, c'est à bord d'un bateau qu'il a fait récemment réparer
qu'il s'apprête à vivre une expérience hors du commun... Et qui
mieux que l'acteur fétiche du cinéaste allemand Klaus Kinski pour
incarner le rôle-titre ? Mais ce que nous apprend tout d'abord
le formidable documentaire Burden of Dreams
de Les Bank entièrement consacré à un tournage houleux qui faillit
ruiner tous les espoirs de Werner Herzog et condamner ainsi son œuvre
au même sort que celui de The Man Who Killed Don
Quixote de
Terry Gilliam dont la première version ne vit jamais le jour, c'est
que le rôle de Brian Sweeney Fitzgerald tomba d'abord entre les
mains de l'acteur américain Jason Robbards qui fut victime d'une
dysenterie qui le condamna à abandonner le projet.
En 1982, le réalisateur
allemand Werner Herzog signait l'une de ces expéditions
cinématographiques dont lui seul a le secret. Après avoir notamment
tourné Herz aus Glas dans
le canton des grisons en Suisse et en Bavière en 1976, il retourne
dix ans après son chef-d’œuvre Aguirre, der
Zorn Gottes
filmer au Pérou l'un de ses plus prestigieux longs-métrages.
Fitzcarraldo
met en scène Brian Sweeney Fitzgerald qui arrivé à Manaus après
avoir effectué un long voyage sur les rivières amazoniennes assiste
à un opéra dont la vedette n'est autre que son idole Enrico Caruso.
Dès lors, Fitzcarraldo va entreprendre un rêve fou : celui de
bâtir un opéra en pleine forêt amazonienne. Aidé par des
centaines d'indigènes et accompagné par une toute petite poignée
d'hommes, c'est à bord d'un bateau qu'il a fait récemment réparer
qu'il s'apprête à vivre une expérience hors du commun... Et qui
mieux que l'acteur fétiche du cinéaste allemand Klaus Kinski pour
incarner le rôle-titre ? Mais ce que nous apprend tout d'abord
le formidable documentaire Burden of Dreams
de Les Bank entièrement consacré à un tournage houleux qui faillit
ruiner tous les espoirs de Werner Herzog et condamner ainsi son œuvre
au même sort que celui de The Man Who Killed Don
Quixote de
Terry Gilliam dont la première version ne vit jamais le jour, c'est
que le rôle de Brian Sweeney Fitzgerald tomba d'abord entre les
mains de l'acteur américain Jason Robbards qui fut victime d'une
dysenterie qui le condamna à abandonner le projet.
Autre
personnalité à avoir quitté l'aventure, le chanteur Mick Jagger
qui refusera finalement de reprendre le tournage, celui-ci ayant été
retardé et le chanteur ayant prévu de sortir un nouvel album avec
son célèbre groupe The
Rolling Stones...
Quelques précieuses images témoignant de la
participation des deux hommes à la première mouture de Fitzcarraldo
nous
sont offertes dans le documentaire de Les Blank et si sans doute
Jason Robbards aurait fait un excellent personnage principal, Klaus
Kinski emporte quant à lui l'adhésion générale. Constitué d'une
somme importante d'images d'archives tournées avant et pendant le
tournage de Fitzcarraldo,
Burden of Dreams évoque
les grandes difficultés rencontrées par l'équipe de tournage et
notamment Werner Herzog qui malgré les pressions et les nombreux
problèmes qui semblèrent vouloir saper le moral et la patience du
réalisateur tiendra bon. Burden of Dreams
est
un voyage au cœur de l'Amazonie et nous rappelle qu'il s'agit d'une
aventure folle et presque mégalomaniaque puisque Werner Herzog
entreprendra à l'aide de centaines d'indigènes de faire passer
modèle de bateau de plusieurs tonnes qu'il a, tout comme dans le
récit fait réparer, au sommet d'une montagne.
Sans
doute le point culminant du long-métrage. Bien que la communication
entre les habitants des lieux et l'équipe de tournage s'avère
parfois compliquée, Werner Herzog filme avec passion ces indigènes
dont le nombre se raréfiait déjà beaucoup à l'époque. Burden
of Dreams,
c'est aussi l'occasion de séquences proprement hallucinantes. Comme
le récit d'un ''accident'' survenu une nuit lors de laquelle un
homme et sa femme du clan des Machiguengas ont été attaqués par
des Amahuacas armés d'arcs et de flèches leur infligeant ainsi de
terrible blessures. Hallucinant puisque inenvisageable chez nous
pendant le tournage d'un film. À tout point de vue Burden
of Dreams
est remarquable. Werner Herzog y expose une vision pragmatique de
l'état des lieux et de ses habitants. Le documentaire de Les Blank
sort parfois de son contexte de strict making-of
pour
s'intéresser à la vie des Machiguengas et des conflits que peut
engendrer par exemple un rassemblement trop important lorsque ceux-ci
sont habitués à vivre en petits groupes. Passionnant, Burden
of Dreams est
un complément absolument indispensable au chef-d’œuvre qu'est
Fitzcarraldo
mais également à l'édifiant documentaire My
Best Fiend
que Werner Herzog réalisera lui-même dix-sept ans plus tard en 1999
et dans lequel il racontait sa ''liaison'' houleuse avec l'acteur
Klaus Kinski...