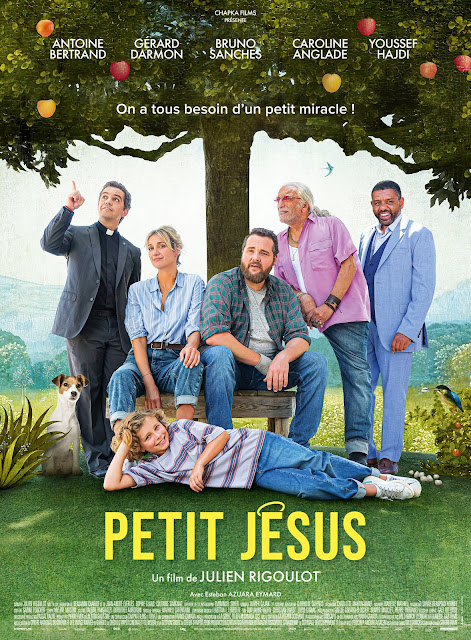Autour de ceux que l'on
évite, qui nous sont transparents, que l'on méprise (parfois) ou
auxquels on donne une petite pièce ou un sandwich pour se donner
bonne conscience, le cinéma et ses auteurs sont parfois bien plus
généreux que le commun des mortels sans même avoir recours au don
d'argent. Si mettre en scène clochards, SDF et marginaux de tous
poils ne fera sans doute malheureusement jamais avancer les choses,
les gagnants sont toujours les mêmes : ceux qui partagent le
temps d'un long-métrage les galères de ces âmes perdues de la
société avant de retourner vivre dans leur petit quotidien
réconfortant. On parle évidemment là des spectateurs. Si l'on s'en
tient exclusivement au cinéma français, le thème mériterait sans
doute quand même que l'on s'attarde sur quelques films étrangers
plus ou moins légers, plus ou moins cruels. Crazy Murder
(2015)
de
de Doug Gerber et Caleb Pennypacker et son SDF serial killer
schizophrène et scatophile. Street Trash
(1987) de Jim Muro et ses amateurs de gniole à un dollar explosant
ou fondant littéralement après absorption d'un alcool nommé Vyper.
C.H.U.D
(1984) de Douglas Cheek et ses clodos contaminés et transformés en
d'affreuses créatures sanguinaires. Prince of
Darkness
(1988) de John Carpenter et sa horde de gueux alliés à un phénomène
diabolique s'attaquant à des étudiants et des scientifiques dans
une petite chapelle. Ou encore le magnifique The
Fisher King
(1991) de Terry Gilliam, rencontre improbable entre un animateur
radio et un vagabond excentrique. Et la liste pourrait être
rallongée à l'infini... En France l'on est moins porté sur une
imagerie délirante que sur l'aspect social de ces femmes et ces
hommes qui n'éveillent en général les consciences que lorsque
l'hiver arrive et que les températures baissent drastiquement. On
pense à La crise
(1992) de Coline Serreau et le personnage de Michou qu'interprète
savoureusement Patrick Timsit. Un individu obsédé par la bière
mais dont la vision de notre société est des plus clairvoyante. Au
formidable Sans toit ni loi
(1985) d'Agnès Varda, lequel remonte le fil de l'existence d'une
jeune marginale dont le corps vient d'être retrouvé dans un fossé
au bord d'une route. À l'inoubliable Une époque
formidable
(1991) de et avec Gérard Jugnot, son histoire et ses personnages
tous plus touchants les uns que les autres. Ou d'une manière
beaucoup plus réaliste et donc radicale, l'excellent Les
invisibles
de Louis-Julien Petit qui a vu le jour sur les écrans français le 9
janvier 2019...

L'on
est sans doute moins chez nous dans l'absurde et l'imaginaire
qu'Outre-Atlantique, mais ces quelques exemples de cinéma hexagonal
prouvent à eux seuls toute la richesse de notre patrimoine
cinématographique. Trois fois rien
est sorti sur les écrans français le 16 mars dernier et reste
l'exemple le plus récent témoignant du sort de ''nos''
SDF. Réalisé par Nadège Loiseau, certains diront qu'il aura sans
doute fallut toute la sensibilité d'une femme pour donner corps à
ce trio de marginaux coincés entre la rue et des épreuves
administratives parfois comparables à celles qui faillirent faire
perdre la tête à deux de nos plus célèbres personnages de
bande-dessinée, Astérix et Obélix lors de l'une des douze épreuves
des Douze Travaux d'Astérix.
Sur un ton nettement plus léger que Les
invisibles
et donc plus proche d'Une époque formidable,
la réalisatrice signe une comédie sociale centrée sur trois SDF
qui viennent tout juste de gagner au Loto. Avec un tel synopsis, on
imagine déjà une comédie classique (genre, Ah
si j'étais riche
de Michel Munz et Gérard Bitton avec Jean-Pierre Darroussin et
Richard Berry) dont la seule différence serait le statut de
sans-abris des trois héros de cette histoire prénommés Casquette
(Philippe Rebbot), Brindille (Antoine Bertrand) et La Flèche (Côme
Levin). Mais là où Nadège Loiseau allie avec intelligence
l'humour et le social, la distraction et les conditions de vie de ces
trois exclus s'inscrit dans la subtile mixité des genres. Un regard
objectif sur les galères de trois SDF liés par l'amitié mais
également par les difficultés qu'ils vont rencontrer. Cette fameuse
chaîne administrative qui contraint ces trois là à trouver un
appartement s'ils veulent pouvoir toucher l'argent d'un gain estimé
par une employée de La
Française des Jeux
à un peu plus de deux-cent vingt mille euros...

Trois fois rien,
c'est aussi trois histoires personnelles, trois personnalités bien
distinctes. La Flèche tout d'abord, qui après avoir été ballotté
de foyers en foyers a décidé de voler de ses propres ailes dès
l'âge de treize ans. Punk à chien, véritable électron libre à l'énergie
débordante, son âge (la vingtaine tout au plus) justifie à peine
son immaturité. Brindille, lui, est celui auquel la réalisatrice
accorde sans doute le plus d'importance. Celui qui veut réussir.
Sortir de la merde et pourquoi pas, revoir son ex-femme et ses deux
enfants. On regrettera que le personnage de Casquette n'ait pas été
un peu plus développé tant Philippe Rebbot s'avère convainquant.
Mais comme le dit si justement La Flèche lors d'un dîner :
''Il ne dira rien.
Pour faire comme dans les séries américaines...''.
À mesure que le récit progresse, le récit devient de plus en plus
intense, émouvant et parfois même, accablant. Nos trois principaux
interprètes (auxquels ont ajoutera les touches féminines que
représentent les actrices Émilie Caen et Nadège Beausson-Diagne)
sont tous les trois formidables, chacun dans un registre sensiblement
différent. Mais des trois, sans doute, l'on oubliera le plus
difficilement l'incarnation de l'acteur d'origine québécoise
Antoine Bertrand, lequel se montre parfois bouleversant. Une comédie
douce, amère, sur l'amitié, la fraternité et une certaine forme de
paternité, dans la droite lignée d'Une époque
formidable
même si ce dernier, dans sa catégorie, semble indétrônable...