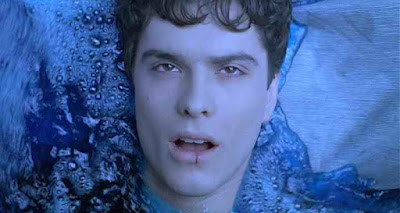Huit années séparent le
premier volet des aventures de Duane Bradley et de son jumeau
monstrueux Belial. Alors que la fin de Basket Case
laissait présager une conclusion funeste pour nos deux héros
télépathes, nous les retrouvons en observation à l’hôpital d'où
ils ne tarderont pas à s'échapper. Sauvés in-extremis des
« appétits » d'une journaliste un peu trop
ambitieuse, ils sont recueillis par une vieille femme et sa
belle-fille dans une demeure accueillant des individus dont la
condition de monstres les empêche de mener une vie sociale normale.
Mais le danger guette. La
journaliste rencontrant des difficultés auprès de la propriétaire
qui refuse de la laisser exploiter l'image de Duane et de Belial, son
patron menace la vieille femme d'indiquer aux autorités l'endroit où
vivent retrancher les deux nouveaux pensionnaires. Mais pour la
journaliste et le photographe qui l'accompagne, rien ne va se
dérouler comme prévu. Malgré les menaces proférées par son
patron envers la vieille femme, cette dernière va leur tendre un
piège avec la complicité des deux jumeaux, de sa belle-fille, ainsi
que des monstres qui peuplent le grenier de la demeure...

Entre Basket Case
premier du nom et cette suite, le cinéaste Frank Henenlotter n'a
tourné qu'un long-métrage, Brain Damage, qui a peu de
chose près reprend une partie des idées développées dans son
premier film. Entre 1982 et 1990, année de sortie de Basket
Case 2, le cinéaste a largement eu le temps de faire des
progrès et peu compter désormais sur le producteur James
Glickenhaus pour investir des billets verts dans ce projet de suite.
Une suite qui d'ailleurs pour le cinéaste n'était même pas
envisagée à l'époque puisqu 'il comptait surtout réaliser une
variation barrée du mythe de Frankenstein dont le titre évoque
forcément la célèbre créature créée par l'écrivain Mary
Shelley. Son titre : Frankenhooker.
Mais s'il veut pouvoir tourner ce dernier, Frank Henenlotter doit
également accepter de réaliser la suite de Basket
Case.
Ce qu'il fera puisqu'il tournera coup sur coup en 1990, la commande
de James Glickenhaus ainsi que Frankenhooker.

On
retrouve au générique l'acteur Kevin Van Hentenryck, celui-là même
qui interprétait le personnage de Duane Bradley. En effet,
contrairement à ce que laissait envisager la fin du premier volet,
Duane a survécu. Belial aussi. Mais alors que dans Basket
Case
l'animation de la créature passait par l'utilisation du procédé de
stop motion (ou, animation en volume), dans
Basket Case 2,
il s'agit désormais d'animatronique, renforçant ainsi l'aspect
réaliste de Belial. Quoique le terme soit quelque peu galvaudé, la
créature conservant toujours son aspect caoutchouc.

Finies
les rues délabrées de New-York et sa faune bigarrée. Désormais,
l'intrigue se situe dans une demeure qui de l'extérieur ressemble à
n'importe quelle maison américaine sauf qu'à l'intérieur s'y
déroulent de curieuses choses. Pour l'occasion, Frank Henelotter
laisse parler son imagination et peu compter sur le maquilleur Gabe
Bartalos pour créer une quinzaine de créatures monstrueuses,
quoique invraisemblables. Dans le principe, Basket
Case est
une comédie horrifique (peu sanglante) dont l'humour (pas
nécessairement drôle) est immédiatement identifiable alors que
dans le premier épisode on pouvait encore se demander dans quelle
mesure il était volontaire. Bien que Frank Henelotter accentue
davantage encore le côté délirant de son récit par rapport au
premier volet, il perd de son charme en intégrant ses personnages
dans un lieu qui demeure trop « propre »
en comparaison de l’hôtel sordide dans lequel vivaient Duane et
Belial jusqu'à maintenant. Basket Case 2
n'est en soit pas une déception, mais il demeure moins... culte que
son grand frère.


%20-%201953%20-%20vostfr%20-%20avc%20-%20dvdrip%20-%20bouskolito.mkv_snapshot_00.30.16_%5B2022.06.18_17.42.31%5D.jpg)
%20-%201953%20-%20vostfr%20-%20avc%20-%20dvdrip%20-%20bouskolito.mkv_snapshot_00.09.12_%5B2022.06.18_17.42.10%5D.jpg)