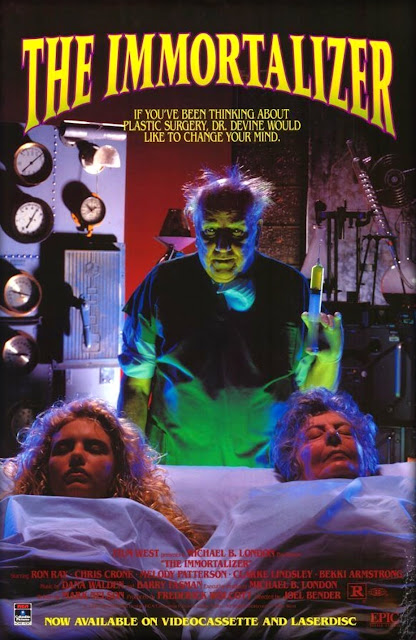Je n'apprendrai rien à
personne en évoquant le fait que le cinéma du réalisateur danois
Lars Von Trier n'a rien de commun avec tout ce que le public à
l'habitude de découvrir sur grand écran. Chacun de ses treize
longs-métrages, de Element of Crime
en
1984 jusqu'au dernier en date, The House that
Jack Built en
2018 est une expérience à part entière. Septième film et premier
volet d'une trilogie qui s'est poursuivie en 2005 avec Manderlay
et dont on attend toujours la conclusion, Dogville
reste sans doute à ce jour comme l'une des œuvres les plus
profondes du danois. Un long-métrage qui, s'il ne reproduit par tout
à fait les préceptes du Dogme
95 cofondé
aux côtés de Thomas Vinterberg en 1995, en récupère certaines
fonctions et semble même aboutir à une épure encore plus
significative du fait que le décor servant de cadre au récit ne
soit constitué que de quelques éléments éparses. Quand bien même
il faudra quelques minutes, et peut-être un peu plus que cela pour
s'habituer à Dogville
dans sa forme, le choix de Lars Von Trier de minimiser l'emploi de
décors permet au contraire de maximiser l'impact de certaines
situations.

Et
pour comprendre, il faut sans doute d'abord se pencher sur
l'histoire... Celle de Grace qui un soir débarque dans la toute
petite ville de Dogville où vit à peine plus d'une trentaine
d'habitants. Parmi lesquels on retrouve immédiatement après le
prologue, le fils du médecin, Tom Edison, qui sans doute troublé
par la beauté de la jeune femme décide spontanément de lui venir
en aide. Car on comprend alors qu'elle est en fuite et tente
d'échapper à des gangsters dont le grand patron est connu sous le
nom de Monsieur Mulligan. Réunis à l'église, tous les villageois
apprennent l'existence de Grace et des dangers qu'elle encoure.
Certains hésitent à l'accepter parmi eux de peur d'en subir les
conséquences. Pourtant, Tom les convainc tous d'approuver la
présence de Grace pour les deux semaines à venir. Et si jamais ne
serait-ce que l'un d'eux décide qu'elle doit quitter Dogville, alors
la jeune femme devra plier bagages...

D'abord
filmé en plongée comme le plan d'une résidence en construction,
Dogville est au départ assez complexe à définir dans son
infrastructure. Car à part quelques fenêtres ici et là et un tracé
au sol qui délimite chaque édifice, le spectateur est invité à
imaginer les façades de l'église, des habitations, ou même des
vieilles mines laissées à l'abandon. Heureusement, l'espace est
suffisamment restreint pour que l'on n'ait pas à retenir
l'emplacement de dizaines de foyers et d'édifices commerciaux.
Officiellement ou non, il se dégage de cette méthode assez
particulière qui fait de Dogville
une œuvre expérimentale à la frontière entre théâtre et cinéma,
un sentiment d'oppression qui peu à peu fini par devenir permanent.
Comme si le personnage central interprété par la magnifique et
bouleversante Nicole Kidman était épié et jugé en permanence pour
ses actes par les habitants qui l'on accueillie un peu plus tôt.
Mais alors que l’œuvre de Lars von Trier s'ouvre et se prolonge
tout d'abord sur un acte d'une grande humanité consistant en
l'acceptation d'une étrangère malgré les dangers, le vice
s'installe au fil du temps dans les foyers pour prendre un caractère
monstrueux.

Cette
monstruosité qui caractérise l'homme lorsqu'il se forme autour
d'une masse populaire vindicative et qu'il sent le danger poindre le
bout du nez. Bien que Dogville repose
sur un scénario original écrit par le réalisateur lui-même, une
étrange relation se noue entre son œuvre et celle plus ancienne de
Clint Eastwood. Un certain Homme des Hautes
Plaines,
western crépusculaire et fantastique (du moins dans sa version
originale) dans lequel l'acteur et réalisateur décrivait une ville
et ses habitants corrompus par la cupidité, la jalousie, la
couardise et la lâcheté...Un casting trois étoiles... Car aux
côtés de la sublime australo-américaine Nicole Kidman, l'y
rejoignent le suédois Stellan Skarsgård, l'américaine Lauren
Bacall, le franco-américain Jean-Marc Barr, ou encore les américains
James Caan et Ben Gazzara, John Hurt étant quant à lui dans la
version originale, chargé de la lourde tâche de narrer ce récit en
un prologue suivi de neuf chapitres. Si dans un premier temps la
forme désoriente, c'est dans la qualité de la mise en scène, de
l'interprétation mais aussi de l'ajout de la superbe partition
musicale empruntée au compositeur et violoniste italien Antonio
Vivaldi que le spectateur trouvera un point d'appui auquel se
raccrocher et ainsi finalement vivre ce film-fleuve de presque trois
heures dans des conditions presque optimales.

Bien
que Dogville
paraisse complexe, l'idée d'y avoir adjoint la voix de John Hurt
permet de clarifier le propos. Car ainsi, tout semble plus simple à
comprendre. Et d'abord, l'agencement de cette petite ville souvent
plongée dans les ténèbres, dont les édifices sont représentés
par d'épaisses lignes blanches et certains éléments par des
symboles ou des mots. À titre d'exemple, si l'on entendra bien
aboyer le seul chien de Dogville, il est représenté par le mot
''Dog''. Comme l'on apprendra par cette même méthode où se situent
par exemple le garage de Ben, la maison de Jeremiah ou encore celle
de Thom Edison. Lieu unique, le décor de Dogville est situé en
Suède, à Trollhättan, et les personnages ne le quitteront jamais.
Même lorsque avec un certain sens du génie, Lars Von Trier cachera
son héroïne entre les caisses de pommes chargées à l'arrière du
camion de Ben. Cruel, Dogville
est un conte allégorique que le public américain a eu du mal à
avaler en découvrant ce qui semblait être une virulente critique
de sa société. On pourrait y voir également une certaine forme de
novélisation de la mythique série Le Prisonnier
créée par George Markstein et Patrick McGoohan au milieu des années
soixante. Grace n'est-elle pas en effet le pendant féminin de
l'agent secret connu sous le nom de Numéro 6, accueillie qu'elle est
par des habitants tout d'abord bienveillants avant de comprendre au
fil du temps qu'elle est elle-même prisonnière de leur moindre
désir et de leur impitoyable comportement envers elle ? En
2003, le réalisateur danois signait sans doute l'un de ses plus
grands films. Dogville est
une expérience douloureuse, inconfortable, étonnante et profonde à
la fois. Habité par des interprètes remarquables auxquels on peut
notamment ajouter l'acteur slovéno-américain Željko Ivanek qui
incarne merveilleusement bien le personnage de Ben ou l'américaine
Patricia Clarkson qui interprète l'odieuse Vera, le film demeure une
expérience inédite à laquelle on pense encore longtemps après la
fin de la projection...