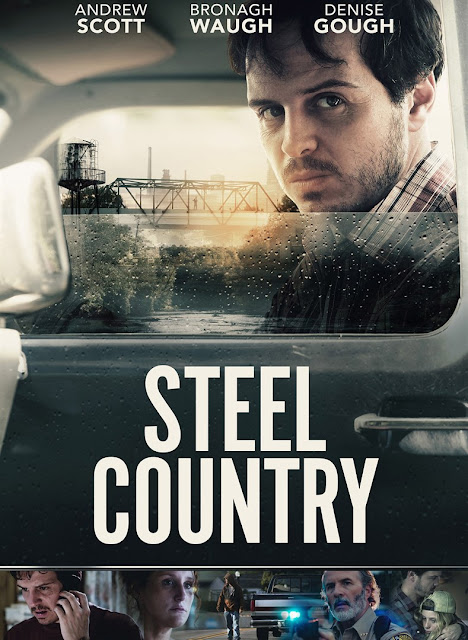Celui que la presse nomme
« L'écorcheur » est insaisissable. Depuis des
années, la police est tenue en échec par ce tueur en série dont
les victimes se comptent par dizaines. Et même si aucun corps n'a
jamais été retrouvé, le sang et les lambeaux de chair découverts
sur les lieux des crimes laissent penser aux autorités qu'il a tué
trente-cinq personnes. Pourtant, et alors qu'il poursuivent un
véhicule conduit par deux gamins, deux agents de police sont les
témoins d'un abominable hurlement s'échappant d'une bouche d'égout.
Après avoir été rejoints par des renforts, ils descendent sous
terre, dans une zone immergée où baignent des cadavres découpés
en morceaux.
Il ne fait aucun doute
que l'endroit est le repaire de « L'écorcheur ».
Celui-ci n'est d'ailleurs pas très loin puisqu'il se cache sous
l'eau. Mais découvert par l'un des agents, il le tue puis tente de
prendre la fuite en remontant à la surface de la ville. Mais pour
lui, la cavale se termine au pieds d'un véhicule de patrouille.
Enfermé dans un hôpital psychiatrique et interrogé par le Docteur
Fallon, le tueur parvient à se libérer et rôde dans tout l'hôpital
dans l'intention de fuir. Mais il lui manque la clé qui lui
permettra de s'échapper. « L'écorcheur » n'est
pas le seul à être enfermé à l'intérieur de l'édifice. Le
Docteur Maggie Belham elle-même tente de fuir, poursuivie par le
meurtrier qui compte bien l'occire comme la totalité des policiers
chargés de le surveiller et qu'il vient de faire passer de vie à
trépas...
Même s'il n'a pas joué
dans un trop grand nombre de longs-métrages, l'acteur Larry Drake,
mort il y a tout juste trois mois, fut bien connu des amateurs de
cinéma et de séries télévisées. Il campa en effet le rôle du
personnage de Benny Stulwicz
dans la série La Loi de Los Angeles, ou encore le malfaiteur
du film Darkman. Maniac Trasher est un
thriller horrifique signé Gregory Gieras, son troisième et
apparemment dernier film puisque depuis 2001 il ne semble avoir rien
tourné de nouveau.
A l'aperçu de l'affiche,
c'est l'inquiétude qui règne. Affreuse, elle donne le sentiment
d'une œuvre de catégorie Z... que le titre lui-même accentue. Un
film que l'on suppose être gore, surtout lorsque durant les
premières minutes, les méfaits du tueurs nous sont contées avec
force détails. L'enrobage étant donc assez repoussant, plusieurs
choix s'offrent à nous : soit l'on s'interdit de perdre une
heure trente à visionner un film qui apparemment n'apportera rien de
neuf sous le soleil de l'épouvante, soit l'on est un grand amateur
de films bis. Dans les deux cas, la surprise sera grande puisque
Maniac Trasher
n'est ni un navet (ne vous attendez quand même pas à découvrir un
chef-d’œuvre ou à un classique du genre), ni un film
outrageusement gore. En fait, il s'agit d'un thriller, d'une chasse à
l'homme longue et bien rythmée. Larry Drake campe un tueur en série
convainquant, et l'actrice Paulina Porizkova une proie elle aussi,
persuasive.
Le film, pourtant, n'est
pas exsangue de défauts. Il lui arrive d'être parfois ridicule.
L'approche un peu démoniaque du personnage de « L'écorcheur »
le rend parfois grotesque, si bien qu'on a parfois l'impression d'une
comédie involontaire. Quand à l'acteur Jürgen Prochnow, l'un de
ceux qui pouvaient légitimement crédibiliser le film de Gregory
Gieras par la seule présence de son nom au générique, il mourra
curieusement assez vite, reléguant l'importance de son personnage au
second plan. Une curiosité à découvrir mais qui ne laissera
certainement pas de souvenirs impérissables...